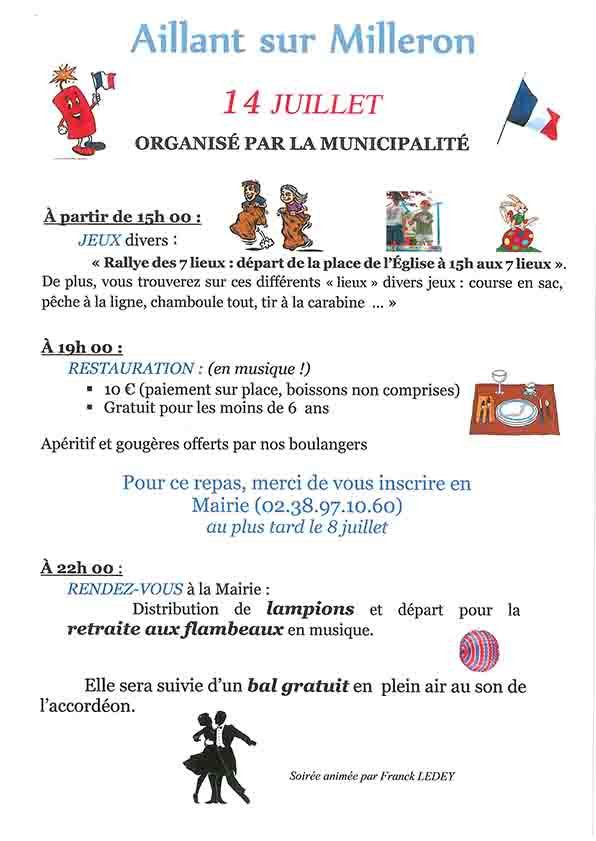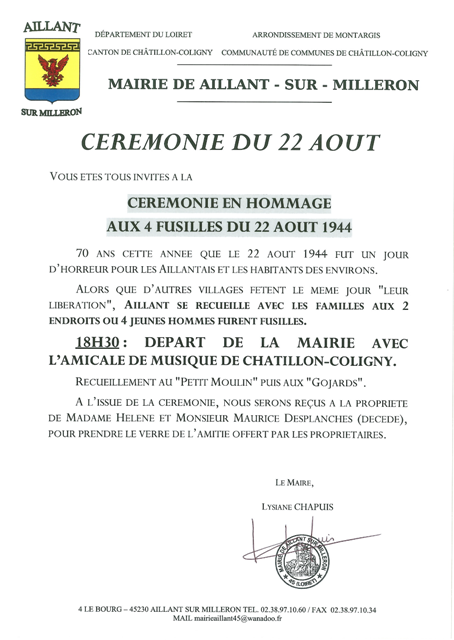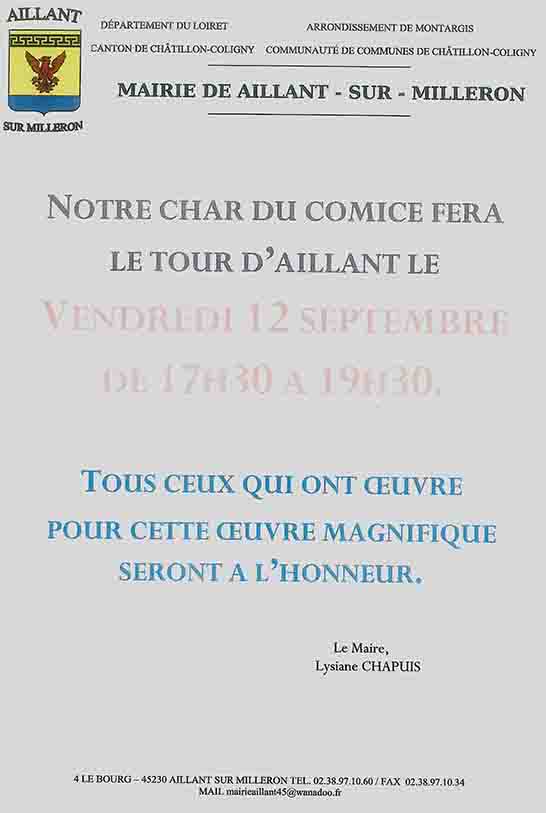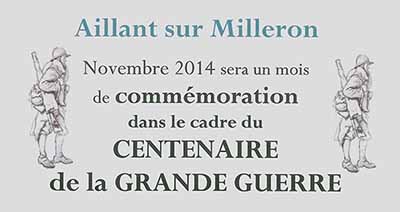1914-1918
HARDY de PERINI Marie Joseph Norbert Jean
Né le 18 mars 1894 à Dammarie sur Loing Loiret
Lieutenant au 18e bataillon de chasseurs à pied
Décédé à MURAT prés de Neuilly Saint Front Aisne
Le 31 mai 1918.
BARRON Gustave Camille Jacques
Né le 7 septembre 1892 à Aillant sur Milleron Loiret
156e régiment d’infanterie
Décédé le 2 octobre 1914 aux combats de Fricourt Somme.
Combats qui ont causé la perte de 36 tués ou disparus et 54 blessés le même jour.
OFMAN Arthur Jules
Né le 5 mars 1884 à Marchais Béton Yonne
20e bataillon de chasseurs à pied
Décédé le 8 novembre 1914 aux combats de Lizerne et Zuydschote prés de Dixmuude Belgique.
Combats qui ont causé la perte de : 7 tués, 23 blessés et 2 disparus.
HARDY de PERINI Félix Marie Ludovic
Né le 26 novembre 1894 à Cosne sur Loire Nièvre
Cavalier 22e régiment de dragons
Décédé le 10 septembre 1914 à Guillocourt Oise
Pas de jmo
PANDEVANT Jules Louis Auguste
Né le 21 novembre 1884 à Aillant sur Milleron Loiret
60e bataillon de chasseurs à pied.
Décédé le 2 octobre 1914 à Neuville Vitasse Pas Calais
Combats qui ont causé la perte de : 22 tués, 38 blessés et 13 disparus.
DEBOURGES Jules Emile Louis
Né le 23 mars 1889 à Aillant sur Milleron Loiret.
82e régiment d’infanterie.
Décédé le 14 juillet 1915 à La Pierre Croisée cote 285 Meuse.
Combats acharnés qui ont duré 3 jours avec emploi des gaz.
Ces combats ont causé la perte de : 96 tués dont 4 officiers,
312 blessés dont 11 officiers et 205 disparus.
RISSET Cyrille Albert Emile
Né le 30 mars 1885 à Dammarie sur Loing
Caporal au 346e régiment d’infanterie.
Décédé le 23 septembre 1914 aux combats de Lerouville Meurthe et Moselle.
Combats acharnés qui ont duré 2 jours et causé la perte de : 56 morts dont 2 officiers, 495 blessés dont 16 officiers et 237 disparus.
RISSET Camille Désiré
Né le 27 février 1880 à Dammarie sur Loing Loiret
20e bataillon de chasseurs à pied
Décédé le 22 aout 1916 aux combats d’Estrées Saint Denis Somme
Combats qui ont causé la perte de 16 tués, 51 blessés dont 2 officiers et 32 disparus.
PAUTRAT Eugene Alfred
Né le 26 décembre 1883 à Bonée Loiret
346e régiment d’infanterie
Décédé le 26 septembre 1914, suite à ses blessures reçues aux combats de Lerouville Meurthe et Moselle.
Combats acharnés qui ont duré 2 jours et causé la perte de : 56 morts dont 2 officiers,
495 blessés dont 16 officiers et 237 disparus.
RIOTAIS Dieudonné Pierre Alexandre
Né le 5 décembre 1883 à Aillant sur Milleron
346e régiment d’infanterie
Déclaré décédé après avoir été porté disparu, aux combats des 22-23 septembre 1914 de Lerouville Meurthe et Moselle.
Combats acharnés qui ont duré 2 jours et causé la perte de : 56 morts dont 2 officiers, 495 blessés dont 16 officiers et 237 disparus.
VINCENS Henri Léon Edouard
Né le 5 novembre 1888 à Paris 16 ieme arrondissement
Lieutenant commandant la 3ieme section de mitrailleuses
du 7e régiment d’infanterie coloniale.
Décédé le 22 Aout 1914 aux combats de Saint Vincent / Bellefontaine Belgique
Combats qui ont causé la perte de 975 tués dont 26 officiers et 322 blessés dont 6 officiers.
Les tirs d’artillerie Allemands ayant atteint les abris où le régiment était regroupé avant l’attaque.
VINCENS Marie Joseph Félix Emile Charles
Né le 3 décembre 1864 à Mauléon Basses Pyrènes
Chef de bataillon au 127e régiment d’infanterie.
Décédé le 23 aout 1914 aux combats de Saint Gérard Belgique
Combats qui ont causé la perte de 41 tués dont 3 officiers
93 blessés dont 3 officiers et 116 disparus.
Les positions ont été bombardées violament à l’aide d’obus explosifs.
MABILLE Armand Hippolyte
Né le 28 octobre 1892 à Chatillon Coligny Loiret
20e bataillon de chasseurs à pied.
Décédé le 18 décembre 1914 aux combats de Notre Dame de Lorette Pas de Calais.
Combats qui ont causé la perte de 18 tués, 122 blessés et 36 disparus.
La veille les combats avaient causé la perte de 71 tués, 145 blessés et 50 disparus.
DUCATTE Emile Jules Ernest Alfred
Né le 10 janvier 1871 à Champcevrais Yonne
Pharmacien aide-major de 1re classe au service de santé.
Décédé le 25 juillet 1917 à son poste : ambulance 1/155, Vaux Varennes Marne.
Une place porte son nom à Villemomble Seine Saint Denis
DESOEUVRES Léon
Né le 27 février 1893 à Aillant sur Milleron Loiret
60e bataillon de chasseurs à pied
Décédé le 2 novembre 1914 suite aux blessures reçues aux combats du 1 Novembre à Bisxchootte prés de Dixmude Belgique.
Combats qui ont causé la perte de 10 tués et 28 blesses.
DESOEUVRES Armand
Né le 6 octobre 1885 à Champcevrais Yonne.
346e régiment d’infanterie.
Décédé le 30 octobre 1915 dans les tranchées de Bois le Prêtre Meurthe et Moselle.
Pertes de la journée ; 2 tués et 2 blessés.
BEZY Pierre
Né le 6 avril 1884 à Rogny les sept écluses Yonne
60e bataillon de chasseurs à pied.
Décédé le 3 octobre 1914 aux combats de Neuville Vitasse Pas de Calais.
Ces combats acharnés ont duré les 2/3/4 octobre et ont causé la perte
de 22 tués, 167 blessés et 185 disparus.
THIBAULT Paulin Adrien
Né le 5 mars 1892 à Aillant sur Milleron Loiret
4e régiment d’infanterie
Porté disparu le 16 février 1915 au ravin des Maurissons
Prés de Vauquois Meuse.
Entre Montfaucon et Varennes en Argonne
Batailles féroces qui souvent se déroulaient au corps à corps, pour quelques mètres de terrain.
Des centaines de morts chaque jour.
Pas de jmo (journal de marche et opération qui rend compte des activités de l’unité au jour le jour)
SECHEPPET Gustave Alexandre
Né le 16 septembre 1880 à Dammarie sur Loing Loiret
82e régiment d’infanterie.
Décédé le 6 septembre 1914 aux combats de Varennes Meuse.
Ces combats acharnés ont duré les 4/5/6 septembre ont causé la perte de pratiquement la moitié du régiment, la plupart des officiers hors de combat tués ou blessés.
CHATON Georges Maurice
Né le 23 avril 1895 à Cepoy Loiret
169e régiment d’infanterie.
Décédé le 30 mai 1915 aux combats de Bois le Prêtre Meurthe e Moselle.
Ces combats très violents ont duré 9 mois, ont causé des pertes énormes :
7083 morts coté français, 6982 coté allemand
CHATON Marcel Paulin
Né le 12 février 1888 à Saint Maurice sur Aveyron Loiret
37e régiment d’infanterie
Décédé le 18 mai 1915 à Amiens Somme
Suite aux blessures reçues aux combats de conquête du cimetière
de Neuville Saint Vaast Pas de Calais.
DEBOURGES Maurice
Pas de fiche individuelle, (fiche individuelle établie par le service aux armées)
82e régiment d’infanterie
Décédé le 25 septembre 1918 aux combats de Salindres près de Courlandon Marne
SIMON Alphonse Désiré
Né le 1 décembre 1889 à Joigny Yonne
82e régiment d’infanterie
Décédé le 14 juillet 1915 aux combats de la Pierre Croisée cote 283 Meuse
Les combats ont duré 3 jours les 12-13 et 14.
Ces combats ont causé la perte de 96 tués dont 4 officiers, 313 blesses dont 12 officiers et 205 disparus.
TURPIN Eugene
Né le 6 mars 1880 à Gien Loiret.
82e régiment d’infanterie.
Décédé le 20 juillet 1915, dans la foret d’Argonne Meuse.
A la suite du bombardement de l’abri ou s’était retranchée son unité.
Bilans 14 tués dont 6 officiers, 48 blessés et surtout 406 disparus dont 4 officiers.
RAGU Paul Alphonse
Né le 30 octobre 1887 à Paris 13 ieme
150e régiment d’infanterie
Déclaré décédé le 17 octobre 1915 après de violents combats à Saint Hilaire le grand Marne, combats du 6 octobre qui avaient causé la perte de 38 tués dont 3 officiers, 163 blesses dont 3 officiers et 174 disparus.
FRANCOIS Marcel
Né le 1 février 1887 à Gien Loiret.
2e régiment de Zouaves.
Porté disparu le 25 février 1916 après les combats du Bois des fosses
Environs de Verdun Meuse.
Combats qui causé la perte de 31 officiers et 1100 hommes en trois jours.
JARRY Paulin Alfred
Né le 22 février 1881 à Aillant sur Milleron
289e régiment d’infanterie
Décédé le 20 juillet 1916 cote 304 à Esnes Meuse
Pas de jmo, ( journal de marche et opération qui rend compte des activités de l’unité au jour le jour)
LEAUX Henri
Né le 15 juillet 1889 à Aillant sur Milleron
151e régiment d’infanterie
Décédé le 25 septembre 1916 aux combats de reconquête du village de Rancourt Somme.
Ces combats ont causé la perte de 99 tués dont 7 officiers, 298 blesses dont 8 officiers et 19 disparus.
MOULE Eugene
Né le 29 avril 1883 à Aillant sur Milleron Loiret
82e régiment d’infanterie
Décédé le 7 novembre 1916 à l’ambulance de Dugny Meuse.
Suite à ses blessures reçues au cours des combats de conquête des forts de Vaux et Douaumont les 3/4/5 novembre.
Ces combats ont causé la perte de 88 tues dont 4 officiers, 292 blesses dont 9 officiers
et 35 disparus.
Les opérations étaient commandées par le général Mangin.
MENGIN Célestin Léon
Né le 30 septembre 181 à Saint Maurice sur Aveyron Loiret.
82e régiment d’infanterie
Décédé le 19 novembre 1916 à l’hôpital Sainte Croix n°6 de Chalons sur Marne Marne
Suite à ses blessures reçues au cours des combats de conquête des forts de Vaux et Douaumont les 3/4/5 novembre.
Ces combats ont causé la perte de 88 tues dont 4 officiers, 292 blesses dont 9 officiers et 35 disparus.
Les opérations étaient commandées par le général Mangin.
DELAHAYE Emile Lucien
Né le 9 juillet 1890 à Aillant sur Milleron Loiret
89e régiment d’infanterie
Décédé le 18 Avril 1917 à l’ambulance 1/96 Guyancourt –Neufchâtel Aisne,
des suites de ses blessures reçues aux combats.
Combats des 15/17 avril qui causé la perte de 65 tués dont 8 officiers, 496 blesses dont 15 officiers et 149 disparus.
Au cours de ces combats qui ont vu l’utilisation de gaz et avions Allemands
ainsi que de chars Français.
GUILLARD Arthur Henri Claude
Né le 15 juillet 1879 à Aillant sur Milleron.
217e régiment d’infanterie.
Décédé le 15 Aout 1917 à l’ambulance 1/55 de Vaux-Varennes Marne, suite aux blessures reçues aux combats près de Berry au Bac.
BIARD Paulin
Né le 28 février 1889 à Aillant sur Milleron Loiret
42e régiment d’infanterie coloniale.
Décédé le 2 octobre 1917 à l’hôpital camp n°1 parc Chambrun à Nice Alpes Maritimes, suite à la maladie contractée pendant son service.
Pas de jmo, (journal de marche et opération qui rend compte des activités de l’unité au jour le jour)
MULOT Louis Albert
Né le 12 juin 1893 à Villeneuve les Genets Yonne
60e régiment d’artillerie
Décédé le 24 avril 1918 au Bois des Gentelles Somme, à la suite du bombardement de la position (pièce d’artillerie) à l’aide d’obus toxiques et explosifs.
BOUQUET Paul Louis
Né le 27 juillet 1897 à Saint Maurice sur Aveyron Loiret
83e régiment d’infanterie
Décédé le 25 avril 1918, aux combats de la ferme Koudekot à Locres Belgique.
Ces combats très violent qui ont duré deux jours les 24/25 avril avaient pour but de contenir une offensive conduite sous l’oeil du Kaiser (empereur d’Allemagne) qui voulait reconquérir la région de Calais.
Ces combats ont causé la perte de 56 tués dont 1 officier, 256 blessés dont 9 officiers et 477 disparus dont 11 officiers.
HERISSON Jacques Marcel
Né le 9 mars 1898 à Dimancheville Loiret.
82e régiment d’infanterie.
Décédé le 14 septembre 1918, aux combats de Courlandon Marne.
Ces violents combats ou le 82 ieme RI était associé au 44 ieme bataillon de tirailleurs Sénégalais ont causé la perte de : pour le 44e bts 310 tirailleurs, pour le 82e ri
12 tués dont 1 officier, 93 blessés dont 4 officiers,
42 disparus dont 2 officiers et 15 intoxiqués par les gaz.
TEPEINT Jules Eustache
Né le 20 septembre 1896 à Aillant sur Milleron
37e régiment d’infanterie.
Décédé le 5 octobre 1918 aux combats de Liry Ardennes
LECLERC Georges Léon Alexandre
Né le 18 février 1897 à Aillant sur Milleron Loiret
172e régiment d’infanterie
Décède le 6 mai 1917, de ses blessures, reçues aux combats du chemin des dames,
combats commandés par le général Nivelle,
à l’hôpital d’évacuation n°32 à Mont Notre Dame Aisne
1939-1945
DELAHAIE Marcel Alexandre
Né le 24 janvier 1912
A Ouzouer sur Trézée Loiret
105e régiment d’artillerie lourde
Décédé en défendant Dunkerque Nord
Le 1 juin 1940
HEUZE François Auguste Noel
Né le 25 décembre 1901
A Villalie Seine et Oise
41e dépôt d’artillerie
Décédé en défendant Saran Loiret
Le 12 juin 1940
VALLEE Georges Francis
Né le 31 mars 1892
Décédé en défendant Dunkerque Nord
Le 31 mai 1940
BIZOT Marcel
LECLERC Jean
MARCUS Marcel
VALERY François
Pris en otages et fusillés
Le 22 Août 1944
Afrique du Nord 1954-1962
PICARD Roland
Né le 14 avril 1937
22e régiment d’infanterie
Décédé le 18 septembre 1960
A Beni Tamou (à proximité de Blida) Algérie